Journée Low-tech, maintenance, limites :
comment repenser le numérique et
ses impacts environnementaux
par Clément Marquet
La journée « Low-tech, maintenance, limites : comment repenser le numérique et ses impacts environnementaux », qui s’est tenue le 20 septembre 2023 à Mines Paris-PSL, était organisée par Clément Marquet (CSI, Mines Paris- PSL, i3) et Florence Maraninchi (Verimag, Grenoble INP – UGA) dans le cadre du projet ALDIWO (Anti-Limits in the Digital World) financé par la MITI du CNRS (lire une synthèse du projet ici). L’événement a réuni une trentaine de participant·es le matin et une quinzaine lors des ateliers.
La matinée était organisée autour des trois interventions de Morgan Meyer (CSI, CNRS, i3), de Jérôme Denis (CSI, Mines Paris- PSL, i3) et David Pontille (CSI, CNRS, i3) intervenant en duo, et enfin de Florence Maraninchi. Clément Marquet a précisé en introduction à la journée le double objectif poursuivi. D’une part, donner à voir des travaux inscrits dans le champ des science and technology studies qui portent sur des notions importantes pour le projet ALDIWO, à savoir le lowtech et la maintenance. Il s’agissait à la fois d’éclaircir ce qui se joue derrière ces termes et de montrer le type de travaux qui sont mis en œuvre par des sociologues. D’autre part, avec la présentation de Florence Maraninchi, il s’agissait de poser le cadre de réflexion du projet ALDIWO en le réinscrivant dans l’activité située d’une professeure d’informatique qui a longtemps été chercheuse dans les systèmes critiques embarqués en temps réel.
« Lowtech et objets frontières » par Morgan Meyer
Dans sa présentation intitulée « Lowtech et objets frontières », Morgan Meyer s’interroge sur la manière dont la notion de « limite » est mise en jeu au sein de divers projets faisant partie de la communauté lowtech française, en adoptant une double démarche : d’abord, problématiser la notion à partir des science and technology studies, ensuite, utiliser cette problématisation pour guider son regard pour distinguer différentes manières de faire exister les limites dans les initiatives lowtech. Pour cela, il commence par prendre une définition simple de la limite : la barre, le seuil, la frontière précisément tracée qu’il ne faut pas franchir, qui détermine le dedans et le dehors. De telles limites reposent sur des approches nécessairement simplificatrices nécessitant de réduire un phénomène à sa part mesurable, quantifiable, chiffrable isolable.
De cette définition, il tire trois enjeux à l’aune des STS. D’abord, les limites sont politiques, au sens où elles ne peuvent être neutres et objectives, mais sont le fruit d’un travail de négociation. Ensuite, les limites changent dans le temps et varient selon les pays. Enfin, au-delà d’une vision trop cartographique ou sensible au tracé, au chiffre qui représente la limite, les STS invitent à prêter attention à la matérialité, aux objets qui peuplent les technosciences, soit en tant qu’ils sont étudiés pour déterminer les limites, soit en tant qu’ils constituent les instruments permettant d’établir les seuils en question.
Pour capturer ces trois apports, Morgan Meyer invite à mobiliser la notion d’objet frontière (Star Griesemer 1989) pour mieux comprendre comment les limites jouent dans les lowtech. Cette notion présente deux avantages : d’une part, elle insiste sur la communication entre différents types d’acteurs ayant une vision sur le monde et qui sont amenés à échanger et trouver des espaces de coordination malgré leurs différences. D’autre part, elle permet en même temps de maintenir une certaine frontière, la différence entre les mondes sociaux n’est pas abolie, elle peut toujours être réinstaurée et la coordination échouer. Il s’agit donc moins de mettre la focale sur l’intérieur d’un territoire, ou sur le seuil en tant que tel, que sur ce qui se passe à la frontière, sur les échanges, l’espace d’indétermination autour du seuil.

A partir de ces précisions notionnelles, Morgan Meyer aborde la question des limites dans le lowtech. En s’appuyant sur une étude de projets variés, il distingue trois rapports aux limites :
La limite comme horizon, ou l’économie d’énergie. Elle s’observe notamment dans les projets d’habitat lowtech mis en avant par le Lowtech Lab (douche qui recycle l’eau, marmite norvégienne). La limite est ici un idéal de la dépense minimale vers laquelle les habitants veulent tendre, tout en conservant un mode de vie relativement confortable.
La célébration de la limite. Cette approche s’est particulièrement donnée à voir pendant la crise covid, en montrant que malgré la pénurie, on peut bricoler et faire des choses importantes et utiles (des masques) avec les moyens du bord, en l’associant avec une mise en narration positive via les réseaux sociaux. Cette pratique « d’innovation par privation » a fait l’objet d’une publication collective dans l’ouvrage Innover en temps de crise dirigé par Hervé Dumez, Benjamin Loveluck et Alexandre Mallard.
La limite interne à l’objet. A partir de l’exemple des fours à pain conçus par l’Atelier Paysan, Morgan Meyer montre comment l’idée de limite peut aller de pair avec celle de pluralisation des objets : refusant de produire un standard auquel tous les corps et artisans doivent s’adapter, l’Atelier Paysan a multiplié les versions d’un même projet de four à pain, afin de favoriser son appropriation par des usagers variés aux besoins très différents. Les contraintes se situent ainsi au niveau de la matérialité même de l’objet.
Pour conclure, Morgan Meyer propose quelques observations sur la place du numérique dans le mouvement lowtech. Si le numérique ne peut évidemment pas être lowtech, il joue un rôle majeur dans la diffusion des modèles, des savoirs et des savoirs faire des communautés lowtech. Il constitue à la fois une brique centrale dans la circulation de l’information, qui est parfois placée à un niveau d’importance égale à celui de la conception d’objets (ex. le tuto des tutos) et un espace de d’expérimentation (faire des sites sobres, intermittents, etc).
« Maintenance et attention à la fragilité » par Jérôme Denis et David Pontille
Jérôme Denis et David Pontille ouvrent leur propos par une définition volontairement large de la maintenance, à savoir faire durer les choses. Cette définition comporte un horizon politique et éthique : s’intéresser à la maintenance, la mettre au premier plan, c’est développer des arguments contre un modèle de l’obsolescence organisée et programmée, modèle économique de développement qui s’est organisé explicitement dans les années 1930 et fait fi de la notion de limites. Par ailleurs, se saisir de la maintenance pour alimenter une telle réflexion, c’est prendre le contrepied des travaux sur l’économie circulaire dans lesquels tout serait recyclable – à l’infini. Au contraire, faire durer les choses constitue un moyen potentiel d’abaisser un certain niveau de production ou de surproduction, tout en gardant à l’esprit que les choses ont une fin.
Faire une place à la maintenance n’est pas un exercice facile. Il faut faire face à la valorisation répandue de l’innovation, à la tendance à l’héroïsation des concepteurs ou des gestes exceptionnels : une réparation dans une situation de crise ou la résilience d’un collectif à la suite d’une catastrophe seront plus célébrés que la maintenance ordinaire, routinière et continue des objets et infrastructures qui peuplent notre monde. Cette difficulté à exister est constitutive de la maintenance, au sens où elle est déployée pour que les choses restent les mêmes, sans différence au premier coup d’œil.
Le geste réalisé au cours de leur travail est donc le suivant : les pratiques de maintenance étant répandues, l’enjeu est de s’y intéresser pour découvrir ce que l’on peut en apprendre, ce qu’elles permettent d’appréhender différemment. Jérôme Denis et David Pontille font ressortir trois enseignements de ces observations.

D’abord, prêter attention à la maintenance, c’est voir des personnes qui sont largement invisibilisées, ou plutôt « négligées ». L’implication de cette observation, c’est que rien n’est autonome, tout a besoin de gens et de choses pour continuer à exister (on rejoint ici les théories du soin qui ont insisté sur l’importance des interdépendances ; voir aussi, dans le domaine de l’architecture, le film Koolhas Housewife, Bêka et Lemoine, 2008). Il y a là un enjeu de description crucial des objets de la modernité : les décrire, c’est également décrire les gens qui s’en occupent. Cela soulève aussi la question de la maintenabilité des objets et donc des conditions de travail des mainteneur·se·s. Cela fait apparaître également une disjonction entre la dynamique d’accélération du monde souvent décrite lorsqu’on parle des technologies de l’information, et le rythme lent, routinier, quasi circulaire des activités de maintenance. Le contraste est particulièrement visible dans le cas du déploiement de la fibre optique, accélérant d’un côté les échanges et de l’autre étant pris dans une cascade de sous-traitance qui contribue à abîmer les travailleurs et à endommager les réseaux. Il ne faut d’ailleurs pas négliger, dans ce contraste, que la maintenance peut être soumise comme de nombreuses activités à une pression managériale croissante enjoignant peut-être un peu paradoxalement les mainteneur·se·s à témoigner de leur productivité et à accélérer leurs interventions.
Ensuite, prêter attention à la maintenance permet de faire émerger une manière très spécifique d’appréhender les choses et les matériaux, qui se distingue d’approches développées du point de vue des concepteur·rices ou des usager·es. Pour le·a mainteneur·se, les choses ne sont pas des objets figés, stables, inertes, mais sont constituées d’une pluralité de matériaux en constante transformation. Ce qui s’impose, c’est la fragilité des choses, qui peut être décrite de deux manières :

Les choses sont fragiles car vulnérables aux chocs extérieurs, aux événements qui surgissent dans leur environnement (c’est l’objet de la science des matériaux que de travailler à leur résistance).
La fragilité est également une caractéristique du développement des choses : les choses sont en train de se faire, de devenir autre, peuvent dévier de ce qu’elles sont censés être, et le travail des mainteneur·es est de parvenir à faire qu’elles restent les mêmes – ce qui peut s’interpréter d’une pluralité de manières,selon ce qui importe dans la situation (par exemple, cherche-t-on à garder l’intégrité matérielle de la chose ou sa fonctionnalité ? l’un et l’autre impliquent deux rapports différents à ce qui doit être maintenu).

L’attention à la fragilité des choses passe souvent par un engagement corporel multisensoriel qui est un élément important de la recherche de Jérôme Denis et David Pontille. Cela suppose une mise en contact, l’entretien d’une certaine proximité avec les choses (même si celle-ci peut être médiée par des outils ou capteurs). Cet engagement contribue à singulariser au plus près chaque objet, chaque machine, jusqu’à parfois les nommer. Cette question de la proximité ne doit pas être prise à la légère, comme une sensiblerie poétique des mainteneur·se·s : elle est organisationnelle et politique. L’enjeu est d’attribuer du temps à une tâche routinière pour qu’elle puisse donner prise à de l’attachement, de la surprise, de l’ajustement – une connaissance fine que de nombreux modes d’organisation ne permettent pas, fonctionnant sur un turn over rapide des employés et dessinant les tournées sur des critères plus ou moins aléatoires. À l’inverse, certaines entreprises défendent un autre modèle de maintenance, reconnaissant l’importance de garder en poste un personnel plus âgé, et laissant à chacun·e la possibilité de cultiver dans le temps un lien de proximité avec les objets dont il ou elle à la charge.
Ces questions de reconnaissance des personnes et de la forme spécifique que prend leur travail interrogent directement la place de maintenance dans le fonctionnement des organisations contemporaines, et notamment sa dévalorisation au sein des outils comptables. Dans de nombreuses entreprises, comme dans les collectivités et les administrations publiques, la maintenance est considérée comme du fonctionnement et non de l’investissement, ce qui la rend peu attractive et difficile à financer : on ne sait pas combien elle rapporte, elle n’apparaît que comme un centre de coûts à réduire autant que possible.
La question du numérique n’a pas spécifiquement été abordée dans la présentation, Jérôme Denis et David Pontille nous invitent à consulter un texte écrit par Mathieu Jacomy, assistant professeur au TantLab de Copenhague, qui a réalisé un travail très riche de dialogue entre Le Soin des choses et son travail de maintenance dans l’opensource. En jeu notamment l’importance que ces communautés accordent à la maintenance et leur difficulté à reconnaître la valeur de ce travail, dans des mondes où tout est fait bénévolement.
« Contraintes, (anti-)limites, optimisation : quelques exemples en informatique (vus de l’intérieur) » par Florence Maraninchi
Florence Maraninchi rappelle qu’elle est initialement chercheuse en méthodes de développement pour systèmes critiques embarqués temps réel. Ce positionnement scientifique a contribué à lui donner un regard particulier sur l’évolution des sciences du numérique, et à la rendre particulièrement méfiante vis-à-vis de l’optimisation et de la recherche de la nouveauté généralement posées comme buts en soi. Cela tient notamment à une sensibilité personnelle pour les questions de fragilité, de surveillance, d’illectronisme et d’impacts environnementaux des technologies.
Concernant ce dernier point, la journée qui nous occupe fait suite à un article publié en 2022 intitulé « Let us not put all our eggs in one basket« . Florence Maraninchi y défend l’idée suivante. Le numérique, au cours des années 2000, a largement été développé par ce qu’elle nomme des « anti-limites », c’est-à-dire des promesses illimitées en temps et en espace. Par exemple, avec la promesse initiale de Gmail : « ne triez pas, ne jetez rien », de Twitter : « tous vos messages seront toujours là », alors que Mastodon propose des choix d’expiration en fonction des instances, et enfin, l’avènement du cloud, conçu comme un supermarché de la puissance informatique sans file d’attente, et devant par conséquent être redimensionné régulièrement en matériel pour permettre à chaque client d’accéder au service souhaité sans attente.
La recherche en informatique n’est pas complètement sourde aux préoccupations climatiques et environnementales. Au fil du temps, deux notions ont été mises en avant pour tenir compte de la responsabilité du secteur :
- Le green IT, c’est-à-dire l’optimisation des systèmes pour qu’ils consomment moins de ressources – mais comme on promet d’en vendre plus, les effets rebonds annulent généralement les gains, voire sont contre-productifs
- Le green-by-IT, c’est-à-dire la promesse de réduire l’impact d’autres secteurs grâce au numérique, et dans des proportions telles que le numérique lui-même serait exempté de faire des efforts de réduction ; c’est un pari risqué
Envisager d’autres pistes, des futurs alternatifs à une croissance sans fin du numérique, sont des objectifs importants du point de vue de la recherche, mais aussi de l’enseignement, car il faut réussir à motiver des étudiants sur des sujets qui, comme on l’a vu, peuvent manquer de valorisation sociale et de visibilité : la maintenance plutôt que l’innovation, le déjà-là plutôt que les promesses de technologies futures enchantées.
Un point de départ pourrait être de s’interroger sur ce qui alimente la croissance et les effets rebonds, de l’intérieur même de la discipline. Cela permettrait de revenir sur une idée répandue : ce serait uniquement la faute des utilisateurs qui en voudraient toujours plus. Pour réfléchir aux principes de conception des systèmes informatiques et à leur potentielle responsabilité dans la croissance du numérique, Florence Maraninchi propose de comparer les principes de conception dans deux exemples de contextes : les systèmes temps-réel critiques d’un côté (par exemple les systèmes numériques dans un train ou un avion), les ordinateurs grand public de l’autre. Dans les deux cas se pose la question du partage entre plusieurs applications des ressources matérielles en calcul et mémoire. Mais dans le premier cas on peut compter sur un cadre relativement contraignant de conception système, alors que dans l’autre cas on vise à produire un objet ouvert et extensible. Ces deux situations extrêmes sont les suivantes.
D’un côté, des systèmes informatiques embarqués critiques pour lesquels il existe un acteur qui, à un moment donné de la conception, a une vue globale : il connaît l’ensemble des applications, leurs besoins précis en temps et en mémoire, il lui est donc possible de répartir le temps de calcul et la mémoire en allouant à chaque application un budget. Chaque équipe développe ensuite en tenant compte de ce budget. Le système complet est peu évolutif, simple, facile à comprendre et valider. Cela en fait une approche de choix pour des systèmes très critiques. L’acteur qui a cette vue globale est un intégrateur. Le choix du matériel peut se faire de manière concertée avec les besoins des applications, les applications sont conçues en tenant compte des limites imposées par le matériel.
A l’autre extrême, pour les ordinateurs portables ou les smartphones par exemple, l’objectif est de permettre l’intervention d’un ensemble de concepteur·rice·s de façon indépendante les un·e·s des autres. On ne connaît pas toutes les applications à l’avance, on n’a pas d’idée claire sur leurs besoins en mémoire et calcul, on fait en sorte que chaque équipe puisse développer indépendamment. C’est pour garantir cette indépendance que les couches basses des logiciels (les systèmes d’exploitation) ont la tâche de fabriquer l’illusion de ressources illimitées. Chaque équipe de développement peut travailler comme si elle disposait d’une machine aux ressources illimitées. C’est le système d’exploitation qui s’occupe ensuite de faire tourner les diverses applications en partageant les ressources de manière dynamique entre elles, de manière transparente [1], c’est-à-dire sans qu’elles le sachent. Bien sûr si l’on charge trop une machine, les limites finissent par se manifester, mais c’est l’utilisateur final qui les subit, et non les diverses équipes qui ont développé leur application de manière indépendante. L’utilisateur final est en quelque sorte l’intégrateur. Comme il n’a pas de pouvoir sur les développeurs, il ne lui reste plus qu’à acheter un ordinateur ou téléphone plus puissant, ou à réduire ses usages.
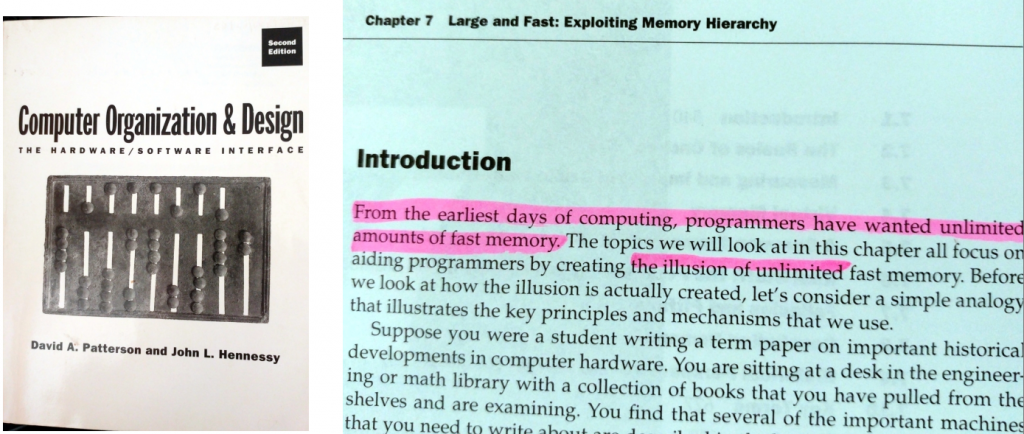
Le principe de conception qui consiste à rendre les développements indépendants les uns des autres est omniprésent en informatique. C’est d’ailleurs ce qui a permis d’atteindre les niveaux de complexité actuels. Or ce principe repose sur des mécanismes de construction délibérée d’une illusion de ressources illimitées. On peut faire l’hypothèse que ce mode de pensée soit devenu tellement naturel parmi les informaticien.e.s qu’il soit difficile de penser les limites du numérique.
Florence Maraninchi clôt sa présentation par une série de questions : l’extensibilité est-elle nécessairement une bonne propriété ? Comment revenir à une conception qui intégrerait des limites, quel serait le juste milieu ? Y-a-t-il d’autres domaines de l’ingénierie qui reposent sur une conception fabriquant l’illusion de l’illimité ? A quel moment ce principe de développement s’est-il répandu au point d’écraser tout le reste ? Qu’est-ce qui nous empêche de penser la dénumérisation ? Autant de questions qui feront l’objet d’échanges avec la salle et de pistes d’exploration pour le projet ALDIWO.
[1] Il s’agit d’une utilisation particulière du terme propre aux sciences informatiques et en particulier aux interactions humain-machine. Dans ces domaines, le fait qu’un process ou un changement soit transparent peut aussi signifier être invisible à l’utilisateur, au sens où l’on voit au travers sans voir ce qui se passe, à l’inverse d’un système ouvert. La notion de transparence y est ainsi souvent synonyme d’invisibilité.

