Didier Torny, Sociologue, Centre de sociologie de l’innovation, (Mines ParisTech, CNRS)
Frédéric Vagneron, Historien, Centre Alexandre-Koyré (EHESS, CNRS, MNHN)
Jamais la carte d’identité génétique d’un nouveau virus n’a été aussi rapidement déchiffrée : le 29 décembre 2019, les premiers cas d’une épidémie causée par un nouveau virus sont déclarés en Chine ; 7 jours plus tard, une équipe de l’université Fudan de Shanghai publie la séquence complète du virus à ARN de la famille des coronavirus. Depuis cette date, les séquençages de ses variants s’accumulent sur le site nextstrain.org avec plus de 120 identifications par des équipes de 20 pays.
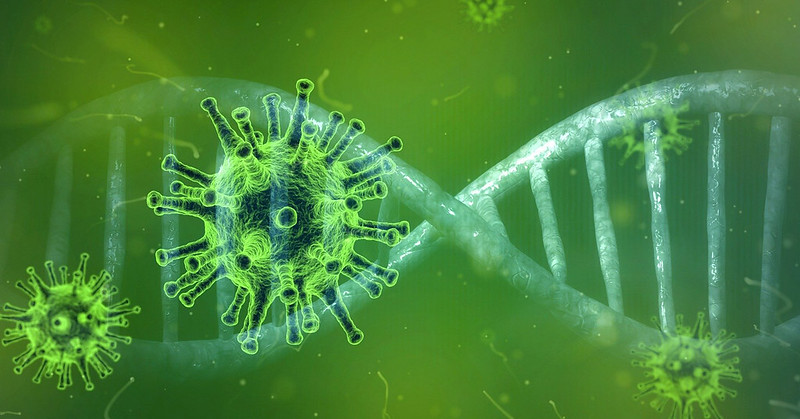
Largement médiatisée, la découverte accélérée pointe une facette peu décrite des réseaux sociaux, leur intensive utilisation collaborative par les communautés scientifiques. Elle intervient dans le contexte de la révolution de la science ouverte. Alors que les résultats lors de l’épidémie de SRAS en 2003 demandaient encore des semaines, l’hyper-rapidité de l’échange des données sur le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 court-circuite les canaux traditionnels de communication scientifique. En effet, c’est désormais la prolifération de prépublications (preprints) beaucoup plus rapidement diffusées que les revues scientifiques, qui donne le la.
Cette accélération dans la production des savoirs présente des risques, comme la faible évaluation avant circulation des résultats ou le partage des données fragmentaires, voire erronées. Mais ils sont collectivement assumés par les communautés qui organisent autrement la discussion entre les pairs, allant jusqu’à retirer en quelques jours des prépublications jugées insuffisantes ou mal interprétées.
Une histoire de chasseurs de microbes
Pourtant, l’identification d’un micro-organisme pathogène, quelle que soit sa virulence, est une tâche difficile. L’histoire des « chasseurs de microbes » est vieille comme la bactériologie, née à la fin du 19e siècle. Dès 1883, les équipes de Pasteur et de Koch se confrontent sur le terrain égyptien pour être les premiers à identifier la cause de l’épidémie de choléra qui y sévit : un jeune chercheur français, Louis Thuillier, y laisse la vie et la commission allemande remporte la course. Largement médiatisés dans la nouvelle presse d’information de l’époque, l’intérêt et le prestige national prédominent. En 1890, face à l’épidémie de grippe qui s’abat sur l’Europe, Louis Pasteur se montre circonspect vis-à-vis de la course à la publication. Harcelé par les questions sur le « microbe » en cause, il s’agace : « je ne sais pas. Encore une fois, que peut-on dire sans preuve ? » Avant de conclure : « On ne sait pas, vous dis-je, il faut chercher » (L’Écho de Paris).

Le 20e siècle a connu un développement exponentiel des connaissances sur les organismes vivants infiniment petits. La virologie, à partir des années 1930, fournit pour plusieurs décennies une quantité remarquable de nouveaux micro-organismes. La famille des coronavirus est ainsi identifiée, au milieu des années 1960, par des équipes britanniques. C’est à cette époque que les connaissances génétiques commencent à permettre une identification routinière des micro-organismes à partir d’échantillons biologiques. Cette démultiplication des savoirs ne dépend pas que de l’ingéniosité des chercheurs : elle nécessite des infrastructures et des pratiques standardisées qui permettent la circulation de souches, le contrôle des résultats des expérimentations, et plus tard des essais thérapeutiques.
Le rôle des organisations scientifiques, mais aussi militaires, a longtemps été crucial dans ce partage des connaissances comme des souches et des réactifs. Mais les intérêts sont divergents : la « solidarité » internationale des chercheurs, si souvent évoquée, est une construction politique. Héritière de l’Organisation d’hygiène de la Société des Nations, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) fait figure de pionnière dans l’établissement de cette coopération entre scientifiques. Pour faire office de lanceur d’alerte, l’organisation de Genève développe un système de réseaux de laboratoires à l’échelle mondiale spécialisés dans l’étude de nouveaux pathogènes. Le programme grippe, établi dès 1948, associe ainsi des équipes internationales organisées autour du Centre mondial de la grippe à Londres pour suivre des virus à la variabilité intrigante. La collaboration n’est pourtant pas toujours au rendez-vous : lors de la pandémie de SIDA, l’identification du rétrovirus, longue de plusieurs années, a mené à une bataille scientifique et financière entre équipes américaines et françaises.
Des alertes internationales, faute de moyens durables
Depuis les années 1980, la santé publique internationale dominée par l’OMS a connu une mutation aussi profonde que durable. Confrontée à des restrictions budgétaires par la stagnation des contributions des États membres, aux défis d’une pandémie de VIH à laquelle elle a tardé à répondre, et à la multiplication d’acteurs privés et publics, l’OMS a recentré ses activités sur la surveillance et l’alerte. Le développement des structures de soin primaire et de l’accès aux médicaments essentiels, initié au cours des années 1970, a été rétrogradé derrière de nouvelles priorités, parmi lesquelles la surveillance des maladies émergentes. Avec la grippe H5N1 (1997, 2005), le SRAS (2003) et H1N1 (2009), l’investissement dans l’alerte précoce et la surveillance s’avère un moyen aussi efficace que périlleux de maintenir le prestige de l’OMS à l’heure de la santé globale.

Surtout mis en œuvre par les pays les plus riches, les plans de préparation initiés par l’OMS depuis les années 1990 visent à définir les modes de vie politique, social, alimentaire, sanitaire en situation de crise et d’interruption des circulations des marchandises, de médicaments et de dispositifs de protection. Mais ils ne peuvent compenser le manque d’investissement pérenne dans les infrastructures sanitaires de base, seules à même de mener à bien des campagnes de prévention et d’établir la confiance des populations dans les pays à faible revenu. En décembre dernier, l’unité d’urgence de l’OMS a publié un communiqué indiquant que 140 000 personnes étaient décédées de la rougeole en 2018, maladie pour laquelle des vaccins préventifs sont pourtant développés depuis les années 1960. Face à l’épidémie de Covid-19, le Directeur général de l’OMS a lancé une aide d’urgence de 675 millions de dollars pour pallier, triste euphémisme, les « différents niveaux d’efficacité dans les mesures nationales de préparation et de riposte ». La somme semble bien dérisoire.
Aussi inédite soit-elle pour la communauté scientifique, la rapidité de l’identification du virus ne peut pas permettre de réduire les inégalités de santé planétaires, et leurs conséquences si visibles en temps de crise. Les frontières ne sont pas uniquement fermées temporairement pour les voyageurs en provenance des zones « à risque », elles définissent des territoires durablement isolés de la solidarité « globale ».
Tribune parue dans Libération le 5 mars 2020, « Covid-19, les frontières se ferment et la science diffuse »
Pour en savoir plus :
Torny Didier (2012). De la gestion des risques à la production de la sécurité. L’exemple de la préparation à la pandémie grippale, Réseaux, 171, 45- 66.
Vagneron, Frédéric (2015). Surveiller et s’unir : Le rôle de l’OMS dans les premières mobilisations internationales autour d’un réservoir animal de la grippe. Revue d’anthropologie des connaissances, 9, 2(2), 139-162. doi:10.3917/rac.027.0139.
Image 1 – Photo source : Prachatai, Covid-19, March 2020. Flickr. (CC BY-NC-ND 2.0)
Image 2 – Source : Dr Thuillier. Mort du choléra en Egypte, Dessin de Henri Meyer (photographie Pierre Petit), Le journal illustré, 7 octobre 1883. Collection BIU Santé Médecine, Université de Paris. (Licence ouverte)
Image 3 – Photo source : Duncan C., Coronarivus, 6 mars 2020, Flickr. (CC BY-NC 2.0)

